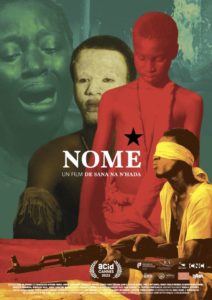 Le film est à la fois beau comme un songe, et aussi cruel qu’un conte… Nome est une coproduction portugaise, française, bissaoguinéenne et angolaise. C’est une fiction tournée en Guinée-Bissau écrite en partie d’après les souvenirs de son réalisateur Sana Na N’Hada, qui filma, avec celle du Cap Vert, la révolution armée et anticoloniale de son pays (1963-1974).
Le film est à la fois beau comme un songe, et aussi cruel qu’un conte… Nome est une coproduction portugaise, française, bissaoguinéenne et angolaise. C’est une fiction tournée en Guinée-Bissau écrite en partie d’après les souvenirs de son réalisateur Sana Na N’Hada, qui filma, avec celle du Cap Vert, la révolution armée et anticoloniale de son pays (1963-1974).
Scénarisé par le portugais Virgilio Almeida et par le guadeloupéen Olivier Marboeuf, Nome se déploie sur trois parties : la description d’une vie de village, les combats et l’exode rural d’une partie de la population, l’après-révolution et l’urbanisation de la société… Autant pour des raisons économiques que par soucis esthétique et éthique, un film de guerre avec un minimum de représentation de celle-ci et le faire depuis le point de vue exclusif des bissaoguinéens et non depuis celui des colons portugais. Ce point de vue est aussi une « rencontre » alors que les films tournés depuis le point de vue des non blancs sont rares ou peu visibles… Nome est donc une occasion de se raconter, de créer une histoire décolonisée avec ses propres mythes, celle d’hommes et de femmes qui se battirent pour une Guinée libre dans laquelle il n’y aurait plus « ni messieurs, ni blancs, ni noirs ».
Nome sort en salle le 13 mars, nous avons choisi de lui consacrer un dossier mêlant retour d’écran et entretiens…
|
dates de la tournée Zoom Bretagne |
retour d'écran : par Léo Dazin
« La lumière de la grande salle se rallume, me rappelant que nous sommes réunis pour une avant-première au TNB, édifice symbole parmi d’autres d’une culture française bourgeoise et nécessairement blanche.
Si mes lunettes bourdieusiennes – et décoloniales – me font davantage encore ressentir le lieu qu’à l’habitude, c’est qu’une fois n’est pas coutume, c’est le nom de l’un des producteurs de Nome, réalisé par Sana Na N’Hada, qui me donna envie d’aller voir ce film dont je ne connaissais rien. Ce nom est celui de l’homme-orchestre[1] et militant décolonial Olivier Marboeuf, dont je suis depuis plusieurs années avec plaisir et curiosité les prises de parole et les travaux écrits comme cinématographiques. Olivier apparait, accompagné de la monteuse du film, Sarah Salem, et du mixeur, Damien Tronchot.
Viennent les usages. Des questions-réponses, des paroles émanant du devant vers un public anonyme et groggy. A peine le temps de sortir du film, de se concentrer sur le récit de son élaboration, d’observer comment Olivier Marboeuf est interrompu lorsqu’il aborde la colonialité contemporaine, que, une séance chassant l’autre, il nous faut évacuer la salle. Comme souvent dans un tel cadre de flux, la promesse de « rencontre » n’aura pas été tenue…
Pour qu’une « rencontre » puisse advenir, que ce soit dans un cadre intime ou conventionnel, l’inattendu et la surprise sont des alliés. Contrevenir volontairement au flux aussi, quitte à saboter de l’intérieur des modalités sociales trop instituées en ne répondant pas aux questions posées ou en faisant dévier la conversation, par exemple.
Cette rencontre, obtenue grâce à une déviation d’attendus et une interruption de flux, je l’ai eue avec Nome.
Filtres caméra de couleur et de diffusion, nuit américaine, objectifs à bokeh déformant, lubrifiant appliqué sur l’objectif, éclairage au miroir, double focale, travelling, steady cam, plans fixes composés, surimpressions, plans composites…Voilà une liste technique bien barbare pour des lecteurs non avertis. Ces usages, tous présents dès le premier quart d’heure du film, sont pour la plupart largement tombés en désuétude dans la production audiovisuelle de flux. Ils renvoient tout autant à un cinéma en noir et blanc sophistiqué qu’à un cinéma de genre ludique, inventif et précaire. Etonnement et ravissement d’observer ce foisonnement qui sera maintenu durant les deux premiers tiers du film (plus le film deviendra urbain, plus il perdra en artifices de mise en scène). Nome démontre en puisant dans la mémoire de l’artisanat du cinéma une vitalité bienvenue dans son artifice même. C’est la marque d’une gourmandise du faire et la preuve d’un dynamisme d’invention entre collaborateurs de création. Un à un, les plans du film sont chacun de petits mondes. Ces plans ont de la mémoire puisqu’ils sentent le crabe, pour prolonger le désir de souvenirs du narrateur fantôme de Nome.
 |
 |
 |
Nome est une coproduction portugaise, française, bissaoguinéenne et angolaise. C’est une fiction tournée en Guinée-Bissau écrite en partie d’après les souvenirs de son réalisateur Sana Na N’Hada, qui filma, avec celle du Cap Vert, la révolution armée et anticoloniale de son pays (1963-1974). Le film, scénarisé par le portugais Virgilio Almeida et par le guadeloupéen Olivier Marboeuf se découpe en trois parties : la description d’une vie de village, les combats et l’exode rural d’une partie de la population, l’après-révolution et l’urbanisation de la société. Autant pour des raisons économiques que par soucis esthétique et éthique, deux partis-pris d’écriture radicaux furent pris : réaliser un film de guerre avec un minimum de représentation de celle-ci et le faire depuis le point de vue exclusif des bissaoguinéens et non depuis celui des colons portugais. Ce point de vue est aussi une « rencontre ». Habitué comme beaucoup aux films de guerre, j’ai surtout eu le point de vue des occidentaux. Et même si certains réalisateurs auront pu montrer une empathie pour les populations racisées, les filmant conséquemment parfois, force est de constater que les films tournés depuis le point de vue des non blancs sont rares ou peu visibles[2]. Raoul Peck aura notamment rappelé dans son Exterminez toutes ces brutes (visible en ce moment sur Arte) comment l’occident impérialiste se sera mis en scène dans ses films, ce qui a largement contribué à la propagation d’une idéologie raciste (l’exemple canonique étant le cinéma américain avec sa représentation des natifs américains). Nome est donc une occasion de se raconter, de créer une histoire décolonisée avec ses propres mythes, celle d’hommes et de femmes qui se battirent pour une Guinée libre dans laquelle il n’y aurait plus « ni messieurs, ni blancs, ni noirs ».

Mais Nome est, dans un même mouvement, également un film iconoclaste. Herzog retournait sa caméra contre sa propre culture autosatisfaite et civilisatrice, Chabrol était fasciné par la bêtise de la bourgeoisie dont il était issu, et Sana Na N’Hada et ses scénaristes se défieront d’une image d’Épinal des combattants révolutionnaires. Nome (interprété par Marcelino Antonio Ingira), c’est aussi le prénom de l’un des personnages principaux du film. Natif d’un petit village rural, ce jeune homme qualifié par sa mère de « fainéant fatigué tel un vieil escargot » tombe en désir pour Nambu (interprétée par Binete Undonque), nouvelle venue et second personnage principal. Nambu devenue enceinte, Nome préférera partir à la guérilla. « Pourquoi les gens deviennent-ils mauvais ?» se demande le narrateur. De vieil escargot du village, Nome se révèle combattant redouté et redoutable, petit chef de guérilla respecté de ses compagnons. La guerre terminée et remportée, Nome devenu requin volera la population avec ses anciens compagnons d’armes et héros de guerre au nom de ce que le pays leur devrait. « Pourquoi les gens deviennent-il mauvais ? » Nome le film n’y répond pas tout à fait. Entre de nombreuses ellipses, le spectateur ne peut être amené qu’à interpréter la conduite de Nome le personnage. Celui-ci n’est pas « incarné » façon pratique habituelle de scénarios de flux, c’est-à-dire psychologisé et donc annulé politiquement la plupart du temps. Nome serait ainsi atteint d’ « un mal qui ne fait pas souffrir ». D’un point de vue structurel, on pourrait supposer que si Nome est devenu mauvais, c’est parce qu’il le pouvait. Son choix était rendu possible. Si l’armée portugaise est bien partie du pays, le pays colon aura néanmoins désertifié les campagnes, laissé ses institutions centralisées, et marqué la Guinée-Bissau de ses pratiques occidentales et capitalistes. Nome l’homme révélé par la guerre perpétuera son savoir-faire à la vie civile et sera devenu un « monsieur ».
 |
 |
|
 |
||
Alors, reste pour Sana Na N’Hada à nous inviter en sa compagnie à s’interroger sur le sens de la révolution. Si des personnes sont atteintes de ce « mal qui ne fait pas souffrir », d’autres seraient-elles « condamnées à voir l’espoir et l’utopie se battre contre la cupidité et le mal » ? Se souvenir de la corde à sauter, de la pêche au crabe et aimer les femmes bissaoguinéennes qui prirent en charge les orphelins du pays serait un début. Mais un début vers quoi ? Une autre révolution ? Assurément pas pour la réforme.
Avoir une pensée politique conséquente et s’intéresser à la décolonisation nécessite une réflexion structurelle. Alors que la bourgeoisie culturelle n’en finit pas de s’autocélébrer par le biais de cérémonies à carpettes tantôt ridicules, obscènes ou senceuses (parfois les trois à la fois !), que la peur du « pêché culturel[3] » l’étreint de toute part et qu’elle ne répond à des problèmes de structure viciée que par l’usage de réformes, Nome participe à des désirs d’émancipation qu’il soient de récit, d’artisanat de tournage, de production, de diffusion et de médiation. Comment interrompre le flux pour écouter modestement et densément ce que nous raconte ce film à goût de crabe, comment accueillir la déviation qu’il nous propose au sein de structures non faites pour lui ? Au sein de quelles structures désire-t-on vivre ? De quel(s) regard(s) a-t-on besoin ?
« La neutralité n’est plus une option. Ceux qui cherchent une fin heureuse à l’histoire, une rédemption ou une réconciliation même, chercheront en vain. Une telle conclusion n’est pas souhaitable [4]. »
Léo Dazin, auteur-réalisateur
mars 2024
—
[1] Olivier Marboeuf est ou fut éditeur, conteur, écrivain, producteur, commissaire d’exposition…
[2] De ce point de vue, on pourra regretter par exemple et entre autres que certains blockbusters indiens contemporains ne soient pas mieux distribués en France, tels que Jawan (Atlee) ou RRR (Rajamouli) qui mettent en scène de façon spectaculaire des luttes anticapitalistes et anticoloniales.
[3] Pierre Bourdieu rappelait dans Les Règles de l’art comment la bourgeoisie française du XVIIIe a joué de la perte d’influence de l’Eglise pour déplacer ses envies civilisatrices, c’est-à-dire son goût, du prêche de curé vers la culture.
[4] Raoul Peck dans Exterminez toutes ces brutes, épisode 1.
Entretien avec le réalisateur Sana na N’Hada (extrait du dossier de presse du film)
 Quel est l’origine du nom du film Nome ?
Quel est l’origine du nom du film Nome ?
Sana na N’hada : Nome fuit son village par peur du déshonneur. Après avoir mis en enceinte une jeune femme, il décide de partir. C’est d’abord la lâcheté qui le mène à la guerre. Sans cela, il ne se serait jamais retrouvé dans la guérilla. À cette époque, chacun de nous avait une raison de partir à la guerre. Il y a des gens qui partaient à cause de leurs engagements révolutionnaires, d’autres pour fuir la répression coloniale des Portugais. Mais beaucoup étaient comme Nome et se retrouvaient face à des situations qui les obligeaient à fuir leur milieu. D’autres personnes ne sont pas parties à la guerre, mais c’est la guerre qui est venue les chercher. Pour moi, c’était à Enxalé, en plein sommeil, dans une hutte en feu. On pouvait donc fuir et se retrouver à la guerre pour beaucoup de raisons, mais dès qu’on décidait de se saisir d’une arme, on entrait dans la lutte pour l’indépendance de la Guinée-Bissau et du Cap-Vert et on acceptait d’y donner sa vie, son corps.
Nome, c’est un homonyme. C’est une manière de dire que la guerre était l’affaire de tous. C’est le nom de tous ceux qui ont rejoint la guérilla. Nous sommes venus des quatre coins du pays. Il y avait des pêcheurs, des éleveurs, des agriculteurs, etc. C’est toute la société qui a participé à ce combat. Même si plus tard, nous avons malheureusement abandonné le pays à quelques hommes d’affaires. Amílcar Cabral nous soudait et il donnait à la lutte une portée noble. Il croyait dans l’union. Sa mort a sonné la débandade. Après l’Indépendance est venu le temps des guerres civiles. L’agriculture, le système de soin… tout s’est écroulé.
Pourquoi avoir choisi la fiction pour raconter cette histoire que vous avez, en partie, vécue ?
Sana na N’hada : Nome est mon troisième long métrage. Avant cela, j’ai surtout réalisé des documentaires. Nome fait partie d’un projet de triptyque que je voulais réaliser à propos de la guerre. Xime (sorti en 1994) était la première partie et se concentrait sur le destin d’une famille guinéenne dont l’environnement se trouvait bouleversé par l’arrivée de la guerre. Le second film devait porter sur ce qu’avaient subi les Guinéens pendant le conflit, mais ce projet n’a jamais abouti. Nome est une sorte de synthèse entre ce qui s’est passé pendant et après la guerre.
J’avais entre 15 et 16 ans lorsque j’ai été recruté pour un stage d’infirmier par les guérilleros. La réalité de ce que fût la guerre ne pourra jamais être saisie, car elle a donné lieu à tellement d’histoires souvent terribles. La fiction m’a permis de rassembler au même endroit beaucoup de personnes et d’évènements différents. Raci, c’est mon enfance, Cuta ressemble à une de mes tantes à qui on attribuait des dons de clairvoyance. Quiti, c’est moi aussi durant la guerre, lorsque j’étais chargé de transporter et de soigner les soldats. Nome est un film choral, il m’a permis à travers ces personnages de dresser le portrait de la société guinéenne. Et dans cette société, il se passe plusieurs choses en même temps.
Dans Nome, cohabitent plusieurs mondes et temporalités guinéennes : la campagne et la ville, la vie quotidienne et le temps ancestral des esprits. D’un côté l’enfant Raci qui cherche à rétablir l’équilibre du village en construisant un nouveau bombolon, de l’autre Nome qui s’enfuit de ce même village et rêve de devenir un notable de la ville…
Sana na N’hada : Amílcar Cabral disait » Nous sommes une société de vivants et de morts ».
La guerre nous a fait faire un saut dans le temps psychologiquement assez vertigineux. Dans mon enfance, nous étions plus proches de nos coutumes. Notre société était une société ancestrale où tout le monde croyait qu’il y avait là-haut quelque chose que l’on appelle Dieu dans beaucoup de langues, mais qui, ici-bas, dans la forêt ou les rizières, s’appelait le monde des esprits. Alors les hommes allaient demander à ces esprits d’intervenir pour régler leurs problèmes. Aujourd’hui, même si les Guinéens se disent chrétiens, musulmans ou agnostiques, cela ne veut pas dire qu’ils ne sont plus animistes. Il y a chez nous un fort syncrétisme. Et quand vient la nuit, nous ne pouvons renier d’où nous venons. Les gens ont des pratiques rituelles ancestrales. Ces croyances forment le terreau de la culture guinéenne qui accepte facilement le mélange. Mon film reflète cela ; cette idée de cohabitation fait partie de l’esprit guinéen. Nous n’avons pas besoin de parler la même langue pour nous marier. Nous le faisons puis apprenons la langue de l’autre. C’est une habitude très ancienne.
Par ailleurs, nous considérons que les gens ne meurent pas. Pour nous, les esprits sont des d’âmes damnées qui errent parce que les vivants n’ont pas pu faire les rituels de deuil ancestraux qui leur permettent de partir en paix. Dans le film, Esprit est ainsi en errance. Il attend et continue de hanter le monde des vivants. C’est un devoir pour chaque Guinéen de faire pour ses morts la cérémonie du tchur. Les morts t’imposent la voie à suivre et on ne doit pas les offenser.
Quel était le rôle du cinéma dans la lutte d’indépendance de la Guinée et du Cap-Vert?
Sana na N’hada : Cabral avait décrété que toutes les personnes qui savaient lire devaient apprendre à ceux qui ne le savaient pas. C’est comme ça que je suis parti enseigner dans un village aux côtés des gens qui luttaient contre les Portugais. Là, j’aurais pu devenir enseignant, mais je n’ai pas pu me déplacer à Conakry, via le Sénégal, pour faire le stage de formation. Je me suis donc retrouvé très jeune dans un hôpital de campagne. Là-bas, ils voulaient des gens capables de se battre, des hommes formés. Et moi, je n’avais ni la carrure, ni l’âge. Au bout de deux ans, on a fini par m’envoyer me former au cinéma à Cuba. Je n’avais jamais vu un film. Je n’avais même aucune idée de ce que cela pouvait être. Les seules images que je connaissais c’était celles de Jésus Christ.
Cette histoire de cinéma a commencé en fait un peu plus tôt, en 1964, quand Mario Marret, un cinéaste français, est venu tourner en Guinée-Bissau. C’était l’un des premiers étrangers à mettre les pieds dans le pays. On retrouve d’ailleurs certains de ses images dans Nome. Par la suite, beaucoup d’étrangers sont venus pour voir ce qu’il se passait ici, des Français, des Cubains, des Italiens, des Soviétique, des Suédois, des Anglais. Cabral a alors décidé qu’on allait faire nous aussi du cinéma pour sensibiliser l’opinion internationale à notre cause. Au même titre qu’on désignait ceux qui allaient se consacrer à la médecine, il a choisit un petit groupe dont je faisais partie (avec Flora Gomes, Josefina Lopes Crato et José Bolama) et on nous a envoyé à Cuba. C’était en 1967, j’avais 17 ans. Nous avons fait le lycée en accéléré puis nous avons étudié à l’institut Cubain des Arts et Industries Cinématographiques. Je suis revenu dans mon pays en tant qu’opérateur caméra et preneur de son en 1972. Cabral avait une vision très claire de ce qu’il voulait faire : filmer la naissance de la Guinée-Bissau indépendante et soutenir par l’image la construction de notre futur pays. Nous étions quatre petits jeunes cinéastes. La tâche paraissait immense. Nous avons donc filmé au quatre coins du pays durant trois ans et n’avons vu le résultat de ce travail que cinq ans plus tard. Ces archives ont été exposées aux intempéries par la négligence des autorités et ont étés partiellement détruites. Il n’en reste que 40% aujourd’hui.
Vous avez également mis un fort accent sur le langage du son et de la musique dans le film. Le Bombolon annonce les conflits et la musique nous replonge dans une certaine ambiance de l’époque, à la fois joyeuse et mélancolique.
Sana na N’hada : Remna Schwarz est le compositeur de la bande originale du film. C’est le fils de José Carlos Schwarz. José Carlos Schwarz était à l’époque un musicien très populaire chez nous. C’était aussi un militant en contact avec la PAIGC, qui a vécu dans la clandestinité. C’était un homme audacieux, ses chansons étaient très populaires dans la guérilla, car il maniait le double sens à la perfection. Si les Portugais n’y voyaient que du feu, les Guinéens eux comprenaient et l’appréciaient. Les chansons de José parlaient de leur quotidien : la guerre, la torture, le deuil des femmes en noir. On retrouve dans Nome une inspiration directe de l’esprit musical de José dans un personnage comme To, par exemple, qui choisit la solitude et l’anonymat pour ne pas perdre son intégrité. J’ai connu José Carlos Schwarz personnellement à la fin du conflit. Nous fréquentions tous les deux le milieu culturel à Bissau. C’était homme très sociable, ami avec tout le monde. La veille de son départ pour Cuba où il venait d’être nommé comme diplomate, il est venu me saluer. C’est à ce moment que j’ai réalisé qu’il éprouvait une sincère sympathie pour moi. Le lendemain, j’ai appris que son avion s’était écrasé avant d’atterrir à la Havane. Nous avons demandé à son fils, Remna, qui est lui-même musicien, de composer les musiques du film à la manière de son père. C’est une forme d’hommage. Comme les chansons de José Carlos, le bombolon a une fonction à double-sens dans le film. C’est une percussion issue des cultures et traditions animistes, présente dans beaucoup de pays d’Afrique. En Guinée-Bissau, le bombolon sert principalement à communiquer, à annoncer des nouvelles, bonnes ou mauvaises. A l’époque de la lutte armée, les jeunes du PAIGC s’appelaient avec cet instrument. Ils faisaient ainsi croire au Portugais qu’ils allaient se divertir, alors qu’il s’agissait en fait de réunions politiques.
D’où viennent les acteurs et comment avez-vous travaillé pour les faire entrer dans cette histoire que nombre d’entre eux ne connaissaient pas ? Vous portez d’ailleurs une attention particulière avec vos personnages à la diversité ethnique de la Guinée-Bissau mais aussi à l’union au-delà des différences que portait en elle la révolution voulue par Amilcar Cabral.
Sana na N’hada : La majorité des personnes qui jouent dans le film ne sont pas des professionnels. Nombre d’entre elles est issu de troupes de théâtre amateurs. Marta Dabo (Cuta), par exemple, est membre de la compagnie « Teatro Lanta »; même si elle a aussi déjà participé à d’autres films. Seule Binette Undonque (Nambu) est une comédienne confirmée. J’avais déjà travaillé avec Marcelino António Ingira (Nome) sur mon film précédent Kadjike. Il avait un petit rôle de commerçant. Alors que nous faisions nos premières répétitions pour Nome et que je cherchais encore mon personnage principal, j’ai pensé à lui. J’ai l’habitude de préparer mes films sur de très longues périodes. Pour Nome, nous avons répété sur plus de douze mois. De temps en temps, lorsque l’occasion se présentait, et que je me trouvais à Bissau, je faisais réunir les personnes intéressées par le projet. Au départ, peu de rôles sont attribués. Ce sont les répétitions qui permettent de déterminer qui jouera qui. Pendant ces moments de travail, je m’efforce d’expliquer à tout le monde ce que j’ai en tête, ce que les personnages ont en tête, ce que j’attends d’eux, le contexte. Avec Flora Gomes, comme nous sommes les deux seuls réalisateurs de fiction en Guinée-Bissau, nous nous efforçons de rappeler des gens qui ont déjà joué pour nous afin de contribuer à faire naître des vocations.
Nome a été tourné en langue créole. C’est un véritable choix car lorsque j’étais petit, on nous interdisait de parler créole dans la salle de classe. J’ai appris à lire, à écrire et à compter en portugais, alors que ma langue maternelle est le balante. Si le portugais était la langue de l’école, en dehors, il n’avait pas autant d’importance. En Guinée, on ne peut pas faire plus de trois kilomètres sans rencontrer quelqu’un qui parle une autre langue. Je parle moi-même quatre ou cinq langues. Les langues et les noms autochtones permettent de déterminer d’où viennent les personnes. C’est très important. La guerre a permis des rencontres. C’est pour montrer cette diversité que les personnages du film nous disent d’où ils viennent à travers leurs prénoms.
Dans sa nature, la Guinée est un terreau multiculturel, les gens se marient entre ethnies. Le créole était au départ surtout parlé au centre nord et à l’ouest du pays, là où l’on trouvait les Portugais. Au début de la lutte, les réunions étaient traduites en plusieurs langues locales simultanément. C’était très long et épuisant. Pour des besoins d’efficacité, la lutte armée a donc contribué à étendre l’usage du créole, car les militants du PAIGC qui venaient de Bissau, le parlaient majoritairement. Aujourd’hui, le créole est la première langue de la Guinée Bissau devant le portugais.
Dans NOME, des images d’archive viennent progressivement dialoguer avec la fiction. D’où viennent-elles ?
Sana na N’hada : Nous sommes revenus de Cuba le 7 Janvier 1972, et avons commencé à filmer la même année. Nous avons retrouvé Cabral à Conakry, qui était la base arrière du PAIGC. Il a présenté au reste du réfectoire notre petit groupe de quatre. Il disait à tous que nous allions réaliser l’Histoire de notre lutte, nous, qui n’étions encore que des gosses. Les guérilleros étaient circonspects. La même année, nous avons filmé Cabral à l’inauguration d’une exposition consacrée aux neuf années de luttes en Guinée-Bissau, un événement auquel ont assisté de nombreuses personnalités de l’époque. Le PAIGC nous avait équipé de caméras Beaulieu R16, de 16mm. À cette époque, Dakar nous servait de base. Nous partions filmer la guérilla et revenions chaque week-end. Treize mois avant la fin du conflit, nous avons décidé de ne plus revenir et de rester sur le terrain. Nous transportions désormais partout avec nous nos bobines de pellicule. Les gens que nous rencontrions étaient très fatigués, sans vêtements, ni chaussures, nous vivions dans des conditions difficiles. Nous étions chargés par Cabral d’aller filmer la vie quotidienne des Guinéens en passant un mois sur chaque front. Notre mission était de lui rapporter tout ce matériau, un an plus tard, en 1973. L’idée était d’archiver la naissance de l’Etat indépendant et libre de Guinée-Bissau. Nous avons filmé des élections de conseillers régionaux, les combats, les campagnes et les agriculteurs, l’éducation, les écoles, etc. Mais Cabral a été assassiné avant que nous ayons pu lui rapporter nos images. A la fin de la guerre nous avons créé un Institut National de Cinéma avec pour mission de contribuer à représenter la diversité du pays. Nous voulions documenter les usages et coutumes de chaque groupe afin de renforcer la cohésion nationale. Nous avons filmé de 1972 à 1977, cinq ans sans voir une image de ce que nous faisions. En 1977, les Suédois ont développé nos pellicules. J’ai été chargé d’aller sur place pour rendre compte de leur état de conservation. Nous avions plus de cent heures de films. Cependant, beaucoup étaient déjà perdues beaucoup car les bobines n’avaient pas été conservées correctement. Sur les cent heures, il ne nous en restait en fait plus que quarante. Je ne sais pas si c’était une si mauvaise chose, car nous avions filmé des évènements effroyables pendant la guerre qu’il valait peut-être mieux ne plus revoir. Le ministre m’a autorisé à sélectionner des bobines. C’est avec ces images que nous avons réalisé notre premier court-métrage avec Flora Gomes, Le retour de Cabral. Ce film a été une manière de finir symboliquement la mission que Cabral nous avait confiée.
Comment pensez-vous que ce film sera reçu en Guinée-Bissau aujourd’hui ?
Sana na N’hada : Je ne m’attends pas à être ménagé, ni à être reçu en héros ! Je ne pense pas que beaucoup de Guinéens recevront ce film avec enthousiasme car, je parle aussi d’un échec. Un échec dont nous sommes tous responsables, dont nous sommes tous coupables, car nous avons voulu un pays, mais lorsque nous l’avons eu, nous nous en sommes désintéressés. En Guinée, on me reproche de toujours parler de la guerre. Ce fut un moment terrible et je ne veux pas passer ma vie à en faire le récit. Je le fais néanmoins car la guerre nous a beaucoup coûté, en sang, en sueur, en faim, en sacrifice, en deuil, en haine car on continue de se haïr encore aujourd’hui et de s’entretuer. Je le fais aussi parce que l’Histoire contemporaine de la Guinée- Bissau est absente des manuels scolaires. Les jeunes guinéens ne savent pas d’où ils viennent. Parfois je vais montrer des films et des images d’archives dans les villages. Beaucoup sont curieux car ils ne connaissent pas l’Histoire de leur pays.
—
|
|
Sana Na N’Hada est né en Guinée-Bissau en 1950. FILMOGRAPHIE : O retorno de Cabral (court métrage co-réalisé avec Flora Gomes – 1976) • Anos no assa luta (court métrage coréalisé avec Flora Gomes – 1976) • Les jours d’Ancono (court-métrage – 1978) • Fanado (documentaire – 1984) • Xime (Long-métrage fiction – Sélection Officielle Un Certain Regard, Cannes – 1994) • Nossa Guiné (documentaire – 2005) • Bissau d’Isabel (documentaire – 2005) • Kadjike (long-métrage fiction – 2014) • Os escultores de espíritos (documentaire – 2015) |
A LIRE AUSSI : 3 questions à… Sarah Salem ICI
 |
Master de philosophie en poche (parcours qui lui a permis d’étudier la théorie du langage), et après avoir pratiqué la bande dessinée, l’édition, l’écriture, la photographie, Sarah Salem se spécialise vers le montage. A l’occasion de la sortie – le 13 mars – du film NOME de Sana Na N’hada produit par Spectre productions (Olivier Marboeuf), elle nous livre la manière dont elle a travaillé avec le cinéaste sur cette matière hybride qui mélange images d’archives et images de fiction pour raconter l’histoire d’une guerre coloniale… Passionnante et passionnée, Sarah Salem revient aussi sur son parcours et sa vision du montage. |
Le film
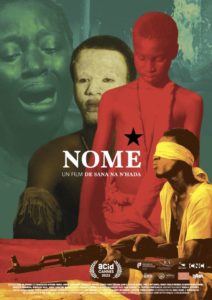 NOME de Sana Na N’Hada
NOME de Sana Na N’Hada
Guinée-Bissau, 1969. Une guerre violente oppose l’armée coloniale portugaise aux guérilleros du Parti Africain pour l’Indépendance de la Guinée et du Cap Vert. NOME quitte son village et rejoint le maquis. Après des années, il rentrera en héros. Mais la liesse laissera bientôt la place à l’amertume et au cynisme.
un film de Sana Na N’Hada
avec Marcelino António Ingira, Binete Undonque, Marta Dabo, Helena Sanca, Paulo Intchama, Abubacar Banóra, Nunha Lúcia Lopes, Jorge Quintino Biaguê, Mário Paulo Mendes, Vladimir Mário Vieira, Oksana Isabel, Ernesto Nambera, Riquelme Biga, Bacari Dabo, Maminha Brandão, Minésio N’Cada, Jorgina Barai, Adelsio M. Biaguê, Papa Lopes, Cadi Sanhá, João Carlos Calon, Justino A. M. Neto
scénario : Virgilio Almeida, Olivier Marboeuf à partir d’une idée originale de Sana Na N’Hada • image : João Ribeiro • son : Tristan Pontecaille • décors : Jose Carlos Victorino • costumes : Lucha D’Orey • montage : Sarah Salem • mixage : Damien Tronchot • étalonnage : Paulo Américo Da Silva • Effets spéciaux : Pierre-Etinne Davy • casting : Jorge Quintino Biaguê
une coproduction LX filmes (Luis Correia) / Spectre productions (Olivier Marboeuf) / Geba Films (Suleimane Biai) / Gereção 80 (Jorge Cohen) / The Dark (Cédric Walther)
—
Festivals et Prix : Gindou Cinéma (2023) / Festival International de Films de la Diaspora Africaine (2023) / Fête de l’Humanité (2023) / Cinémigrante (2023) / Festival Indépendences & Créations (2023) / Waterloo Historical Film Festival (2023) / Festival Monde En Vues – Guadeloupe (2023) / Festival Cinémartinique (2023) / Festival International du Film Indépendant de Bordeaux – FIFIB (2023) / Festival Visions d’Afrique Oléron (2023) / Carthage Film Festival (2023) / Festival des Cinemas d’Afrique APT (2023) / Luanda International Pan African Film Festival – PAFF Prix du Grand Jury Meilleur Long Métrage Du grain à démoudre (2023) / IFFR – International Film Festival Rotterdam (2023)
Grand Prix de la Compétition Internationale -Mention spéciale pour l’actrice Binete Undonque (2023)
Prix du Grand Jury Meilleur Long Métrage Du grain à démoudre (2023)
Best Director -Best Film -Best Actress International Images Film Festival – IIFF – Zimbabwe 2024






