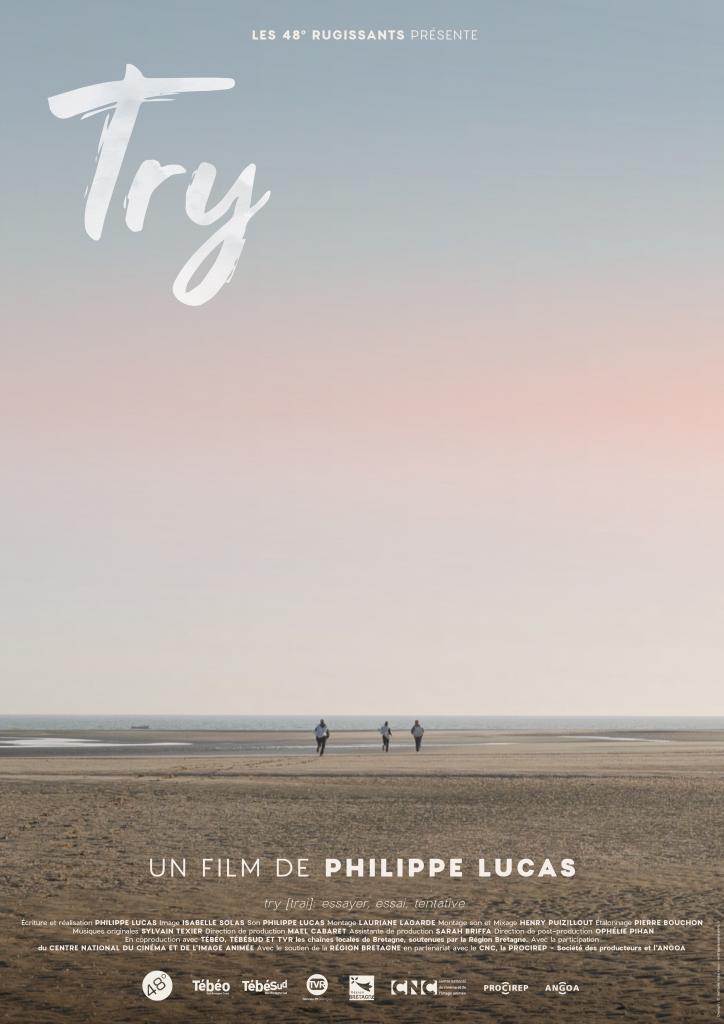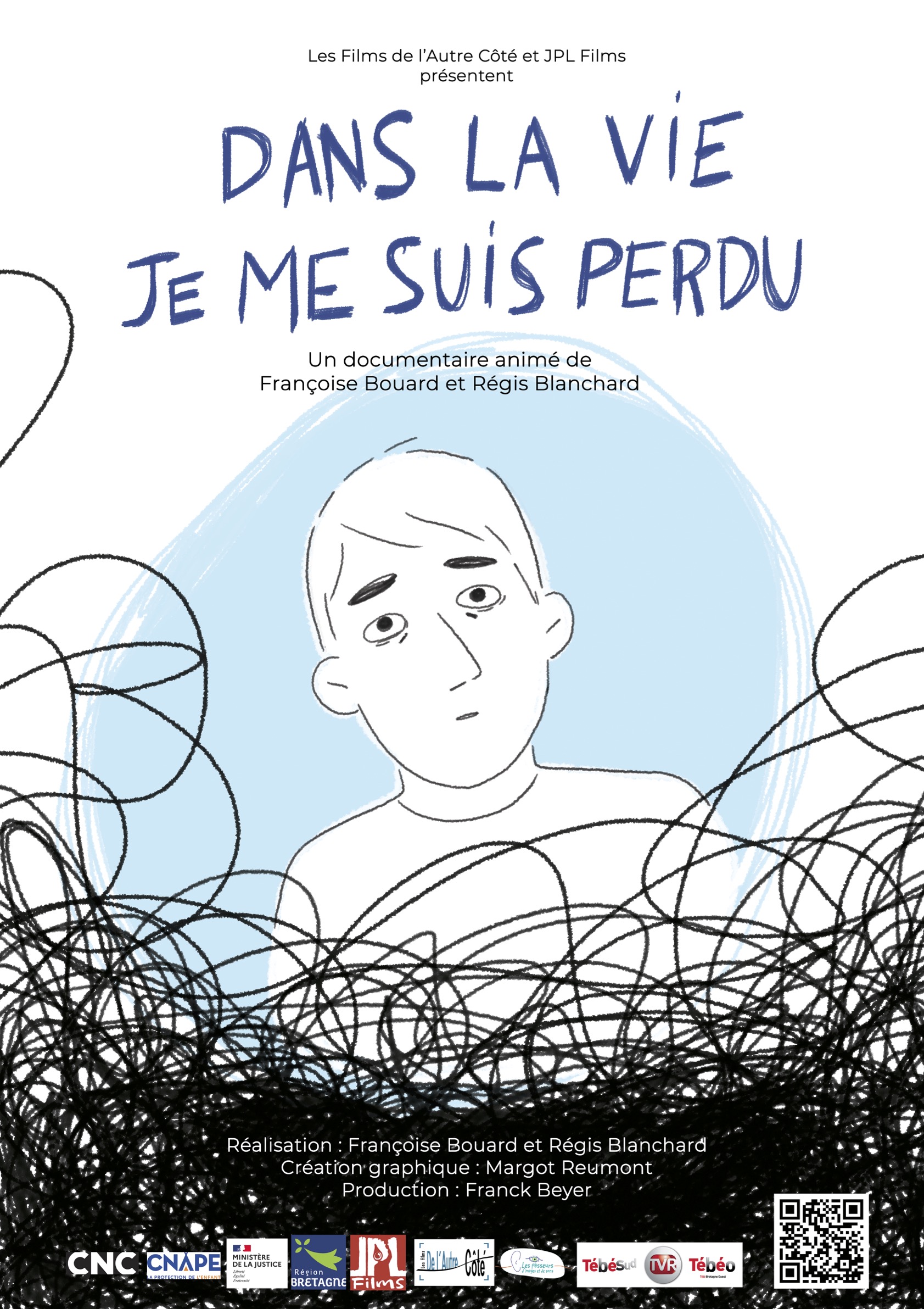Les lendemains, long métrage réalisé par Bénédicte Pagnot et produit par Gilles Padovani (.Mille et Une. Films), sera projeté dans le cadre du festival de cinéma Douarnenez le 27 août à 18 h au cinéma Le Club. A cette occasion, nous republions l’article paru lors de sa sortie en avril dernier. A suivre un article sur Lann Vraz de Soazig Daniellou, également projeté à Douarnenez.
– Bénédicte Pagnot, votre film parle du passage de l’adolescence à l’âge adulte. Où remonte votre désir de film ?
– Bénédicte Pagnot : j’avais envie de parler de cette période particulière où l’on change d’univers, on rencontre d’autres gens, on se rend compte que le monde est plus grand que celui où l’on habite, que les différences sociales sont plus grandes que celles du bled d’où l’on vient.
Et puis, j’avais participé activement à un mouvement de chômeurs en 1998. Ce fut un moment important dans ma vie où j’ai appréhendé très concrètement les questions du militantisme, du collectif. Comment, alors que l’on est tous d’accord pour changer les choses, on constate finalement que l’on n’est pas si d’accord sur la méthode. On se rend compte que si l’on est trop peu, on n’arrivera pas à changer le monde et à la fois, si l’on fait entrer d’autres personnes, cela risque de compliquer les choses.
A partir de là, j’ai imaginé cette fille, Audrey. Elle est restée dans ma tête pendant plusieurs années. J’ai raconté le synopsis à Gilles en 2003 et mon désir d’en réaliser un long métrage. J’avais seulement réalisé un court métrage et Gilles n’en avait produit que deux. Ca me semblait trop tôt pour s’attaquer à un long métrage mais Gilles m’a dit : « Ca va prendre du temps, autant s’y mettre dès maintenant ! ».
– Gilles Padovani : ce début d’histoire m’intéressait et j’avais envie d’y aller. Je suis tatillon sur l’écriture et je savais qu’il fallait qu’on dépose à l’avance sur recettes un projet bien abouti. Tout ça a pris du temps. C’est assez impressionnant le travail que représente l’écriture. Sans compter que chacun de notre côté on menait d’autres projets de films en parallèle.
– Pouvez-vous revenir sur l’aventure de production du film ? Comment s’est passée la recherche de financement ?
– G.P. : pour l’écriture, on a obtenu en 2004 l’aide au développement de la Région Bretagne, ce qui a permis à Bénédicte d’écrire les premières versions du scénario plus sereinement. Puis on a obtenu l’aide au développement du CNC, début 2007, et on a finalement eu l’avance sur recettes un peu plus d’un an après. Entre-temps, on était allé frapper aux guichets d’aide à l’écriture et d’aide à la réécriture des Régions Centre et Basse-Normandie, mais cela n’a pas fonctionné.
On a eu l’avance sur recettes en 2008, du premier coup et à la quasi-unanimité, ce qui est assez rare. Pour nous c’était une grande nouvelle. Sans l’avance sur recettes, je savais que l’on aurait eu du mal à faire ce film. Mais dès lors, tout paraissait possible. La suite logique était de trouver une télé. Seulement, à part Arte, les télévisions comme Canal+ ou France Télévisions ne s’engagent sur un projet que s’il y a un distributeur cinéma. On a très vite envoyé le projet à Arte. On a reçu une réponse négative tout aussi rapide. Pour les distributeurs, je me suis d’abord dirigé vers les gros/moyens, du genre BAC, Les films du Losange, Diaphana, etc. Silence radio, mis à part un rendez-vous arraché auprès de BAC, pour s’entendre dire qu’ils venaient de s’engager sur D’amour et d’eau fraîche, une histoire assez proche et que ça ne serait donc pas possible. Là, s’est confirmé ce que je commençais à entrevoir : les films ayant obtenu l’avance sur recettes – et donc estampillés auteur – répondent rarement aux envies du marché.
– Comment avez-vous surmonté cet obstacle ?
– G.P. : j’ai décidé de revoir mes ambitions à la baisse et je me suis adressé à 3 plus petites sociétés dont UFO, notre actuel distributeur. On s’est rencontré, on a discuté du scénario. Ils ont fait des remarques pertinentes qu’on a prises en compte. J’ai pu alors m’adresser aux autres diffuseurs et là j’ai eu la confirmation que la seule véritable question à laquelle on est confronté lors de la première prise de contact concerne le casting. On est allé voir France 3 Cinéma et Canal+ chez qui on a eu un rendez-vous où l’on nous a expliqué que les places étaient très chères pour la case du mardi soir. En fait, cette deuxième partie de soirée est destinée aux premiers et deuxièmes films d’auteur et donc réservée aux jeunes réalisateurs. Mais comme des réalisateurs plus aguerris ne parviennent plus à accéder aux autres cases plus prestigieuses, ils viennent squatter celle-là. Aujourd’hui, sur les 25 films de cette case, seuls 3 ou 5 sont des premiers longs. Au final, malgré l’intérêt – sincère je pense – de la chargée de programme, on n’a pas eu Canal et donc aucun diffuseur national.
Il restait CinéCinéma, les Soficas et les Régions et on a tout fait en parallèle. Les Soficas, on les a presque toutes essayées, sauf 2 pour lesquelles on n’avait aucune chance d’entrée de jeu. On n’en a eu aucune. L’absence d’un vendeur international a été pénalisant. On a aussi essayé les Régions. On réunissait déjà les critères de la Bretagne donc on savait que l’on pouvait tourner ailleurs. On a essayé l’Ile-de-France, le Centre, la Haute-Normandie, Aquitaine, Pays-de-Loire… Rien! Et j’ai fini par avoir la réponse, négative, de Cinécinéma en pleine préparation, un mois avant le début du tournage, alors qu’ils avaient le projet depuis plus de neuf mois.
– A ce stade de la fabrication du film, vous n’aviez donc pas bouclé votre financement?
– G.P. : non, les 3 millions du budget prévisionnel fondaient comme neige au soleil. Ce fut un passage compliqué. Cela prenait beaucoup de temps et face à autant de réponses négatives, ça a été un peu tendu entre Bénédicte et moi. C’était d’autant plus difficile que l’on manquait d’expérience. Fin 2010, deux ans et demi après l’avance sur recettes, on savait que l’on n’aurait pas grand-chose de plus. C’était un peu la désillusion. Même si on avait une deuxième région, on était bloqué par le maximum des 60% d’argent public autorisé. Alors s’est posée fin 2010 début 2011, la question de la suite. Concrètement, dans le meilleur des cas, on aurait un million et pas trois. C’était un gros bouleversement. Bénédicte ne voulait pas couper son scénario et moi je ne pouvais pas imprimer des billets.
Bénédicte Pagnot (au centre) avec Pauline Parigot et Fanny Sintès. Photo Richard Volante
– Quelles concessions a-t-il fallu envisager ?
– B.P : moi je réfléchissais beaucoup à quel film j’avais envie de faire et comment j’avais envie de le faire. Comme je fais de la fiction et du documentaire, je me suis rendu compte que je me sentais mieux dans la démarche du documentaire. Je préfère être dans un temps qui est celui de la vie des gens, plutôt que dans la fiction où il faut tout planifier, avec des temps de travail bien quadrillés. Alors j’ai dit à Gilles que les fictions qui me plaisaient étaient faites avec des équipes réduites, proches d’une démarche documentaire. A mon sens, c’était vers ça qu’il fallait aller, sans compter que l’on n’avait pas d’argent pour envisager autre chose. De toute façon je n’avais pas envie d’une grosse équipe. Par contre je voulais du temps.
– G.P : une petite précision. Pendant toutes ces années, j’ai produit deux courts métrages de fiction de Bénédicte. J’ai pu appréhender sa façon de travailler. Ainsi en 2009, Mauvaise Graine, son dernier court métrage, a aussi été produit comme une expérimentation. Je me suis positionné sur ce film dans l’idée que l’on se projetait dans le long métrage à venir. C’est aussi là que j’ai convaincu Bénédicte de tourner en numérique. Je sentais venir le manque de financement et j’ai pensé qu’il valait mieux s’y essayer dès maintenant, plutôt que de le vivre comme une contrainte sur le long. À la fin de la production de Mauvaise Graine, on s’est vraiment dit que Bénédicte était quelqu’un qui avait besoin de temps. Les plans de travail de ses deux courts métrages n’avaient pas pris en compte cette composante, alors inconnue, et on se retrouvait avec des journées de 15 à 18 heures. C’est une leçon importante que l’on a tirée pour le long.
– B.P : la grande majorité des premiers longs se tournent en 5 ou 6 semaines. Pour moi c’était impossible. Gilles l’avait déjà intégré.
– G.P : il ne fallait pas couper le scénario et il fallait au moins 8 semaines de tournage. Compliqué.
– B.P : au début c’était même 9 ou 10… Au départ, je ne voulais pas tourner à Rennes à la base. C’est une concession. Je préférais Caen où j’avais déjà tourné Mauvaise graine. On y avait des relais de confiance, ce n’était pas trop loin, mais cela impliquait tout de même un effort financier. On s’était dit 50/50 pour la répartition du tournage entre Rennes et Caen. Finalement, on a fait 3/4 et 1/4, mais j’aurais aimé que ce soit dans l’autre sens.
– Face au manque d’argent, quand avez-vous décidé de lancer le tournage malgré tout ?
– G.P. : début 2011, avec 650 000 euros en cash, on s’est dit : on prend une toute petite équipe et on y va ! Et j’ai continué à chercher de l’argent. Je suis allé trouver Dominique Hannedouche de TV Rennes 35 et je lui ai exposé les faits en avançant qu’il s’agissait d’un long métrage entièrement produit en Bretagne, écrit en Bretagne, tourné en Bretagne, etc. Il a répondu présent et m’a dit que même si la plateforme des TV locales n’a pas vocation à s’engager sur des longs métrages, il avait envie de participer au projet. Ils se sont réunis avec Tébéo et Ty télé et au final, ils ont décidé d’y aller. Pour nous, c’était un peu d’argent en plus.
À l’époque, l’idée était de faire la post-production en Belgique pour bénéficier du Tax Shelter (crédit d’impôt, ndlr). J’avais un coproducteur en Belgique prêt à suivre et j’avais déjà visité les studios. Mais à ce moment-là, AGM est entré dans la danse. J’ai rencontré Yann Legay pendant la préparation du film. Il m’a certifié que son studio serait prêt dans les temps et que l’on pourrait post-produire à Rennes début 2012. Pour nous, cela représentait de la disponibilité, de la proximité. On a donc laissé tomber la Belgique. AGM a fait un effort sur ses tarifs pour faire partie de l’aventure et on est entré en coproduction.
– Comment s’est passée la post-production ?
G.P. : c’était vraiment super d’être chez AGM. On a vécu la post-production comme tous les réalisateurs et producteurs parisiens, alors que sinon c’est toujours une galère de déplacement, d’hébergement. Et puis, le fait qu’il soit coproducteur et qu’on essuyait un peu les plâtres de la toute nouvelle installation, a permis d’avoir une exigence encore plus grande. Le film devenait alors entièrement breton, sans compter que la comédienne principale – Pauline Parigot – est rennaise. C’est à ce moment-là que j’ai réussi à convaincre TV Rennes de s’engager via le fond Ville de Rennes. A l’été 2011, au début de la préparation, on savait enfin où on allait !
Le problème, c’est que tout cela a pris tellement de temps que l’avance sur recettes était devenue caduque. Il a donc fallu la représenter, alors que l’on avait déjà commencé le casting. Mais, de mon côté, j’avais de bons échos, me rassurant sur le fait que, s’il y a eu du boulot de fait sur le film pendant les deux années précédentes, cela devrait passer… même si rien n’est jamais garanti. Heureusement, on a eu une réponse positive le 4 mai 2011. Cela fait date ! On avait déjà notre directeur de production et on avait des vues sur le chef-op et le premier assistant réal. Bref, l’équipe totale était réunie fin mai, début juin, et les repérages ont commencé dans la foulée, mi-juin.
Une partie de l’équipe de tournage. Photo Richard Volante
– Comment se sont passés la direction d’acteur et, plus précisément, le travail avec Pauline Parigot ?
– B.P. : c’est Christel Baras qui s’est occupée du casting. Elle a un don pour trouver des premiers rôles. Elle a fait venir Pauline Parigot qu’elle connaissait à titre personnel et Pauline Acquart qu’elle avait découverte pour Naissance des pieuvres. Elle les a fait jouer ensemble. Pour nous, ça a été tout de suite une évidence. Pour les rôles des squatteurs, j’étais persuadée que je ne trouverais pas mes acteurs dans les agences parisiennes. D’où l’importance de compléter mon casting à Rennes et à Caen.
Par ailleurs, j’avais compris pendant le casting qu’il y avait une grande différence entre les filles de 17-18 ans et celles de 23 ans. Les plus jeunes comprenaient très bien la première partie du film – quitter le cocon familial, découvrir la fac, la colocation – alors que les plus âgées se retrouvaient davantage dans la seconde, le squat, etc. Pauline fait partie de la première tranche d’âge. Il m’a donc semblé important de tourner dans l’ordre chronologique pour qu’elle vive cette découverte comme son personnage, plutôt que d’avoir à recréer une forme d’insouciance.
– G.P. : c’était une vraie découverte pour Pauline. Elle découvrait un plateau, le cinéma. Cela correspondait à ce que vivait son personnage, en pleine découverte, et lui donnait une fraîcheur, une certaine innocence.
-B.P. : cette fraîcheur, on a essayé de la retrouver dans le choix de la petite équipe. Matthieu Chatellier, le chef-opérateur, avait comme moi une petite expérience en court métrage de fiction mais venait surtout du documentaire. Pour Valentin Dahmani, c’était son premier long métrage en tant que premier assistant. Et moi, j’avais fait des courts, mais je restais encore assez fragile. Du coup, on n’était pas dans un rapport écrasant. On se respectait beaucoup dans l’équipe. On était dans une espèce d’humilité et cela a eu des conséquences bénéfiques sur le jeu de Pauline.
De même, afin de garder une grande proximité, j’ai choisi de supprimer le HMC, habillage, maquillage, coiffure. Par le passé, j’ai été stagiaire mise-en-scène et deuxième assistante réalisateur et j’ai passé des heures dans des loges accrochée à un talkie-walkie. Le monde du HMC, c’est une bulle intéressante mais qui coupe le comédien du plateau et donc du réalisateur. Cela conduit à une surprotection des comédiens qui m’agace profondément. Donc… pas de vrai HMC. J’aimais l’idée de faire un film assez brut et ça allait aussi dans ce sens.
– Quelle a été votre relation avec le chef-opérateur, Matthieu Chatellier ?
-B.P. : Matthieu et moi, on était contents de faire le film ensemble. On a décidé de travailler avec très peu de lumière, un peu à la manière du documentaire. On a regardé plusieurs films ensemble pour échanger, s’inspirer. On voulait profiter de la lumière naturelle, des possibilités qu’offrait la caméra, plutôt que d’être dans des artifices.
– Pensez-vous que ce film puisse ouvrir la porte à d’autres productions de longs métrages de fiction en région ?
-G.P. : Microclimat, le long métrage Marie Hélia, produit par Paris-Brest, nous avait montré que c’était possible. Pour Les lendemains, c’était un peu différent, on avait l’avance, un distributeur, les télés locales, mais c’est aussi un film d’ici. Quand on a eu l’avance sur recettes, pas mal de gens étaient soufflés, car ils se disaient que c’était possible. Depuis, JPL Films a eu aussi l’avance pour un film d’animation. J’espère que ce long métrage est le début d’un mouvement. »Les lendemains » va sortir dans une quarantaine de salles dont 6 rien qu’en Bretagne la première semaine, ce qui est assez exceptionnel pour ce type de film. Normalement pour notre distributeur, c’est plutôt 2 salles. L’idée, c’est bien sûr de s’appuyer sur le fait qu’il s’agit d’un film fait ici et de renforcer cette sortie en Bretagne. Maintenant, espérons que le film saura trouver son public !
Propos recueillis par Mael Cabaret
[mk_gallery images= »4546,4548,4549″ column= »3″ height= »322″ frame_style= »simple » disable_title= »false » image_quality= »1″ pagination= »false » count= »10″ pagination_style= »1″ order= »ASC » orderby= »date »][/vc_column][/vc_row]